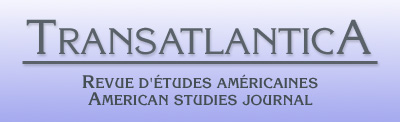
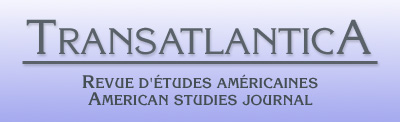 |
|
Dossier Les Couleurs de l'Amérique Dossier préparé et présenté par Hélène Christol (Université de Provence) et Géraldine Chouard (Université Paris 9) De quelle(s) couleur(s) est l’Amérique? Comment penser (à) l’Amérique à travers le prisme de la gamme chromatique? Y-a-t-il des couleurs ou des associations de couleurs plus américaines que d’autres, et si tel est le cas, lesquelles et pour servir quels enjeux? A contrario, manque-t-il à l’Amérique certains tons du nuancier? Et comment dire enfin ces couleurs pour qu’en retour, elles nous disent quelque chose de l’Amérique? Autour de cet ensemble de questions, et de bien d’ autres encore, nous nous sommes retrouvés, au congrès de l’AFEA de Pau, au mois de mai 2004, pour débattre ensemble de la couleur de l’Amérique, dont il est immédiatement apparu qu’elle devait se décliner au pluriel. Ce qui fut fait lors des manifestations, conférences et débats qui ont entouré les quatorze ateliers du congrès.
Le congrès s’est ouvert avec la conférence plénière de Ricki Stevenson, historienne et journaliste, qui a réinscrit la relation de la France aux Afro-américains dans le contexte du passé. Fondatrice du « Black Paris Tour » (visite guidée de la ville autour des afro-américains), elle tient la chronique des Noirs américains venus chercher inspiration à Paris. Paris, rive noire, lieu où les couleurs douces-amères de l’exil tracent les lignes et les rythmes qui ramènent au pays d’origine. Car dans ce pays où la géographie rejoint l’histoire, le croisement s’opère autour d’autres coloris bon teint, depuis l’opposition entre Peaux-Rouges et Visages Pâles, sur laquelle se fonde la genèse du Nouveau-Monde, relayée par la «color line» qui marque la ségrégation entre Noirs et Blancs. Rouge, blanc et noir: c’ est autour de ces couleurs primaires qu’il faudrait peut-être rebaptiser spectrales, que se sont regroupés deux ateliers. « La couleur du temps », que dirigeaient Arlette Frund et Claude Julien, explora, entre omniprésence et oubli, le jeu de plusieurs temporalités qui ont fixé, capté, mémorisé ou effacé la singularité de l’expérience afro-américaine. Quant à l’atelier d’Anne Ollivier-Mellios, « Le rouge et le noir: Radicalismes aux Etats-Unis », il proposait d’articuler la question de la couleur autour des mouvements contestataires qui se sont opposés à l’Amérique mainstream. Ces deux ateliers ont ainsi donné aux couleurs d’Amérique une forte intensité politique et sociale, qu’est venue compléter une table ronde, animée par Vincent Michelot, où furent débattus les enjeux des élections américaines et les orientations de la future présidence.
Libre déambulation hors des sentiers chronologique, thématique, symbolique, un diaporama a enchaîné quelques cent-soixante images de l’Amérique à travers une collection disparate de certains de ses arts de la couleur: peinture, photographie et patchwork. Composé par Géraldine Chouard, réalisé par le photographe Michel Lebrun, ce diaporama évoluait sur une musique de John Cage, choisie par Didier Machu, invitant le regard à une traversée du continent où se succèdaient géométrie et fantaisie, paysages et collages, unis et bariolés, femmes et fleurs, fleurs et fruits, pour que, dans une sorte de réverbération instable, se reflète une synthèse utopique des Etats-Unis, sur le mode du chatoiement. Autant d’americamaïeux, en quelque sorte, pour ouvrir grand les yeux à l’Amérique et tenter d’en voir la couleur. Couleur-lumière, mais aussi couleur comme forme qu’évoquait, au rez-de-chaussée de l’un des bâtiments du campus, une exposition des œuvres de Jim Dine, sommairement ficelée à des grilles d’affichage selon une technique artisanale qui n’aurait pas déplu à l’artiste, lui qui avait tant aimé, enfant, la quincaillerie de son grand-père. Une trentaine de photographies de ses œuvres les plus caractéristiques accrochaient ainsi le regard des passants: portraits, vêtements, outils, palettes, cœurs et bouquets, mêlant époques et genres, supports et matières. Retraçant le parcours graphique de celui qui « incarne une pensée sur le visuel qui aborde et dépasse les orientations majeures de l’art américain de la deuxième moitié du vingtième siècle », Anca Cristofici souligne que chez Dine « la couleur fait partie d’un vocabulaire minimal dont il tâte le potentiel expressif: pâteuse, palpable, posée en couches sur les objets, sur les sculptures ou sur la toile, elle est une possibilité de forme ». A la confluence de plusieurs traditions de l’image et à travers leurs riches effets de surface, cette exposition était ainsi un libre florilège de sa production, « comme une invitation à revoir le siècle qui vient de passer d’un regard impatient, curieux, interrogatif ». A Pau, les arts visuels ont fait l’objet d’un certain nombre de communications. L’atelier de Bertrand Rougé: « Tableaux/ Drapeaux: les couleurs de la nation », partit du postulat que « si certains drapeaux font des tableaux, certains tableaux finissent par fonctionner comme des tableaux ». De l’école de la Hudson River jusqu’à la « photo-couleur » contemporaine, l’Amérique y fut évoquée à travers les « véhicules iconiques » de certaines formes attestées de sa tradition picturale et photographique. Atelier synchrétique placé sous le signe de l’arc-en-ciel, « La Couleur haute définition », présenté par Véronique Beghain, a mis l’accent sur « la différentiation, le rapport des couleurs entre elles et le passage d’une couleur à l’autre ». Entre métissage et homosexualité, il y fut aussi question de bande dessinée. Pour poursuivre ces débats, le samedi après-midi, une table ronde présentée par Géraldine Chouard a réuni Annie Cohen-Solal, Bernard Hœpffner et Bertrand Rougé. De « l’avènement de la peinture américaine » jusqu’ au pop-art, et au-delà, jusqu’à la période contemporaine, en passant par les expérimentations synchromistes (de Morgan Russel et Stanton McDonald Wright) et les compositions modernistes de Guy Davenport, l’objet était de définir la palette américaine, et les intervenants ont tantôt évoqué l’usage que ses peintres avaient fait de la couleur, tantôt dégagé certaines de leurs préférences, tandis qu’ici et là étaient signalées quelques-unes de leurs influences. Plus tard, dans le joli cadre du palais Beaumont, autour de cocktails colorés, ont été présentés quelques photographies des menus chromatiques de Sophie Calle. Adepte de la littéralisation en matière d’art, Sophie Calle eut un jour l’idée de composer les menus monochromes que Paul Auster avait imaginés dans son Leviathan. Elle réalisa ainsi sept clichés pour les sept menus de la semaine (lundi: orange; mardi: rouge; mercredi: blanc; jeudi: vert, vendredi: jaune, samedi: rose, et dimanche: multicolore).
Dans une sorte de saturation du rapport entre couleur et sens, peinture et photographie accomplissent dans leur matérialité propre l’expression même de la couleur métamorphosée en substance, que l’Amérique a figurée ou transfigurée, au fil des surfaces où elle s’est manifestée. Mais aussi au fil de ses textes : car la couleur est en littérature l’un de ses champs les plus signifiants, et à l’instar du titre de l’atelier de Bruno Montfort et d’Anne Ullmo, il a été bien sûr fortement question « des textes et des couleurs » que l’Amérique nous offre depuis sa genèse. A travers des auteurs qui ont marqué de leur empreinte « colorée/colorique » les lettres d’Amérique, de Cooper à Updike, en passant par Hawthorne, Thoreau et Poe, cet atelier interrogeait la notion de la vérité de la couleur en littérature: « Cosmétique ou incarnée ? », telle était en somme la question. Comment la couleur fait-elle signe et sens ? Par quels moyens s’appréhende-t-elle dans un texte ? L’atelier d’Isabelle Alfandary et de Claire Fabre: « Du blanc typographique à l’encre de la lettre: écriture et non-couleur » gravitait autour de tels questionnements, en s’intéressant plus particulièrement aux conditions matérielles de la production d’une écriture (en prose comme en poésie). Situées « aux extrémités du spectre chromatique », ces deux couleurs offraient une « tension optique maximale » à l’analyse critique. Poursuivant cette enquête, « Sémiotique de la couleur » dirigé par Arnaud Regnaud et Béatrice Trotignon, cherchait à son tour à « faire parler la couleur » et à comprendre les moyens de son expression. Explorant « les systèmes sémiotiques mis en place par la fiction pour construire une visibilité du monde », il y fut question de « coloral », signe qu’en matière de couleur, la langue ne cesse de se réinventer.
«De quelle(s) couleur(s) est l’Amérique ? »: c’est à cette même question que répondaient, chacun à sa manière, les différents participants du film qui fut par ailleurs présenté aux congressistes. Co-réalisé par Géraldine Chouard et Anne Crémieux, « Couleur(s) d’Amérique » est un documentaire pour lequel ont été interviewées des personnes dont l’Amérique est le sujet, à différents titres: Américains, américanistes, adeptes de l’Amérique. Au fil des rencontres se sont succédés les témoignages, et alors que se croisaient générations et couleurs de peau, les impressions ont fait écho aux partis-pris tandis que les petites histoires rejoignaient la grande. Au fil des entretiens, les couleurs d’Amérique sont tour à tour devenues historiques, politiques, esthétiques, linguistiques et toujours idiosyncrasiques. Evoquant leurs premières impressions des Etats-Unis, les découvertes qu’ils y avaient faites, leurs expériences de terrain ou leurs savoirs acquis ici et là, les intervenants ont réactualisé la question à travers une grande diversité de points de vue, instaurant entre eux, sans jamais se rencontrer, une relation active faite de suggestions, d’échanges, de rappels. Si pour les uns la couleur renvoyait inévitablement à la question de la race, d’autres évoquaient le rouge et le noir des conflits sociaux, le bleu-blanc-rouge du drapeau, le vert et le gris des espaces contrastés, le vermillon de certaines toiles, ou le jaune des citrons de la Californie. « And much, much more ». Comme il se devait, le cinéma a fort bien été représenté au congrès de Pau, avec deux ateliers, dirigés par Melvyn Stokes et par Dominique Sipière, qui ont tour à tour déroulé une part de la toile immense du cinéma américain. Quel rapport s’établit donc entre les couleurs ? Quels liens se tissent entre des objets, images, états d’une même couleur ? Peut-on établir un lien entre le blanc de Melville, le white-on-white des premiers quilts américains et les monochromes de Brice Marden ? Dans leur atelier, « The Whiteness of America », Nathalie Cochoy et Pascale Antolin acueillaient Sophie Lévy, du Musée Américain de Giverny, venue présenter une «exposition en », pur produit de l’imaginaire d’une conservatrice spécialiste de l’art américain, qui s’est ainsi plu à rêver pour nous un assemblage unique de tableaux—ce qui est peut-être en soi le signe de la constance utopique de l’Amérique en général et du blanc en particulier. C’est l’une des couleurs retenues pour rassembler les articles de cette publication, couleur singulière, monochrome et pourtant multiple, à la fois absence et somme de toutes les nuances de la palette, déclinée par plusieurs ateliers sous des angles divers comme le montrent les textes de Marie-Odile Salati et de Marie Bouchet où la blancheur se place sous le signe du fantasme, géographique esthétique et/ou érotique.
Poursuivant cette enquête chromatique, Marc Chénetier fait dans le bleu, ou plutôt dans les bleus de William Gass, Alexander Theroux et Jean-Michel Maulpoix. « Composant avec le bleu » à son tour, il trouble le jeu, le nourrit de ses sens indéfiniment ramifiés, ouvrant les perspectives latérales, traquant les manifestations secondaires de cette couleur plastique entre toutes pour rendre compte de l’affect qui la traverse et qu’elle diffuse « corps et âme ». S’interroger sur la couleur en Amérique, c’est ainsi tenter de mettre à jour ce que sa langue en fait, comment elle en joue / jouit, pour que précisément, l’Amérique puisse révéler its true color. C’est à travers son expérience de traducteur que Bernard Hoepffner se livre à l’examen de ce que devient le bleu d’une langue à l’autre. Entre source et cible, il arrive que le bleu devienne diable, ou pour reprendre une expression de Nabokov (qui s’y connaissait en matière de couleurs), qu’il se «démonise».Pour prendre la mesure du bleu made in USA, peut-être faut-il encore se perdre dans le ciel des tableaux de Hopper, regarder l’Amérique dans le bleu des Zyeux de Jerome Charyn, penser aux blue-jeans de James Dean ou soutenir le regard de Toni Morrison, le plus bleu d’Amérique. Au-delà du blanc et du bleu, les couleurs ont aussi la fantaisie de se rejoindre dans divers types de combinaisons. Entre le monochrome et les quatre couleurs de la bande dessinée que retrace Jean-Paul Gabilliet dans son étude, l’Amérique se situe peut-être dans cet « au-delà de l’arc-en-ciel » peint par Guillaume Marche, dans la réfraction et la dispersion des couleurs primitives en un faisceau multicolore d’identités multiples. Dans On Being blue. A Philosophical Enquiry, William Gass élevait la couleur à une dimension philosophique, interrogeant le bleu dans tous ses états. On being blue / white / green / red / yellow / purple / pink / any or no color at all in America, les perspectives restent ouvertes pour les américanistes européens que nous sommes, prêts à dessiner de nouvelles cartographies en couleur d’un territoire qui n’en finit pas d’être à explorer.
Toutes les images ©Jean Kempf 2004
Vous pouvez soumettre réactions, commentaires, références et notes de lectures sur ce thème au rédacteur-en-chef de TransatlanticA. |
||