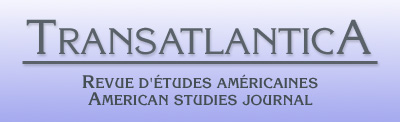
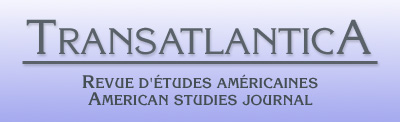 |
|
Journée « Autour du livre de François Cusset French Theory » et des Cultural Studies [19 novembre 2004] Compte rendu coordonné par Marie-Jeanne Rossignol (Paris VII) et Pierre Guerlain (Paris X)
La parution du livre de François Cusset, French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et les mutations de la vie intellectuelle aux Etats-Unis en 2003, à La Découverte, a soudain donné une plus grande visibilité en France aux Cultural Studies et autres mouvements intellectuels inspirés de théoriciens européens (et non seulement français) qui ont fleuri aux Etats-Unis pendant les vingt années passées. Ce livre tout à fait passionnant, érudit et ancré dans une expérience personnelle (l'auteur, sociologue, travaillait aux Services culturels français à New York pendant la période) a engagé quelques américanistes curieux de ces mouvements intellectuels à se réunir pour discuter des thèses de Cusset et à élargir le débat aux Cultural Studies et à leur inscription universitaire ainsi qu'à leur impact politique. Organisé à l'initiative de Marie-Jeanne Rossignol et Pierre Guerlain, ce forum Paris7/Paris X s'est tenu le 19 novembre à l'Université Paris X-Nanterre. Il a réuni les participants suivants : Françoise-Michèle Bergot, Cornelius Crowley, Paris X-Nanterre, Craig Carson, Nanterre, Marc Deneire, Nancy 2, Pierre Guerlain, Paris X - Nanterre, André Kaenel, Nancy 2, Alison Halsz, Paris X-Nanterre, Thierry Labica, Paris X-Nanterre, Hélène Le Dantec-Lowry, Paris III-Sorbonne Nouvelle, Catherine Lejeune, Paris 7-Denis Diderot, Guillaume Marche, Paris XII-Val de Marne, Brigitte Marrec, Paris X-Nanterre, Jean-Paul Rocchi, Paris 7-Denis Diderot, Marie-Jeanne Rossignol, Paris 7-Denis Diderot. Les intervenants ont souvent tenu à mêler rappel de leur expérience personnelle, analyse de l'ouvrage et réflexion sur les Cultural Studies lors de ce forum de réflexion, dont vous est ici livré ici un compte rendu légèrement révisé, où alternent brèves interventions et développements plus étoffés.
Pour résumer rapidement sa thèse, on peut dire que selon François Cusset, de remarquables intellectuels comme Foucault, Deleuze et autres brillants penseurs des années 1970 ont trouvé un meilleur accueil aux Etats-Unis qu'en France à partir des années 1980 : ce sont les campus américains qui ont profité de l'incroyable fermentation intellectuelle présente dans leurs travaux, pour diverses raisons, et en particulier, la structure du milieu universitaire américain. Aux Etats-Unis, les idées et l'imagination ; à la France, de bien ennuyeux « nouveaux philosophes » qui ont paradoxalement accompagné les années de gauche au pouvoir. Catherine Lejeune: Indéniablement, French Theory donne un socle théorique aux Cultural Studies. Cependant François Cusset, à l'instar d'autres penseurs marxistes, ne manque pas de les critiquer (qu'il qualifie, au passage, de « disciplines abâtardies »). Pour François Cusset, les seules études ethniques qui valent sont celles qui concernent les Africains-Américains. Elles seules ont acquis leurs lettres de noblesse. « La question afro-américaine », dit-il, « justifiant une étude des ségrégations est un cas à part, plus ancien, plus impératif, chargé d'une plus lourde histoire : de fait, elle relève moins d'une création universitaire que les Chicano, Asian-American, Native-American Studies ou même les Gay/Women Studies ». Nul ne contestera la centralité, la primordialité de la question afro-américaine, mais le survol est là trop rapide, et de ce fait réducteur. Peut-on ainsi mettre tous les groupes ethniques sur le même plan compte tenu de la différence des situations d'un groupe à l'autre, qu'il s'agisse de la nature et de l'ampleur de la discrimination ou de la teneur des combats pour les droits civiques passés et présents ? De surcroît, chacun de ces groupes a eu sa part de réalité ségrégationniste. Il y a donc une histoire raciste et/ou discriminatoire de ces populations dont on ne peut réduire l'étude, contrairement à ce qu'affirme Cusset, au seul besoin d'existence intellectuelle au sein de l'université.
Dés le début de French Theory, François Cusset définit l'enjeu d'une étude à la fois riche et synthétique. Il s'agit en fait « [d'] explorer la généalogie politique et intellectuelle, et les effets, jusque chez nous et jusqu'à aujourd'hui, d'un malentendu proprement structural » entre théories françaises et universités américaines (15). C'est l'occasion pour Cusset de se pencher sur les conditions de production de la théorie, du difficile rapport entre émission nationale et réception étrangère dans lequel elle s'inscrit, mais aussi de porter un regard critique sur l'universalisme français et le communautarisme américain. French Theory reflète bien en effet la crispation identitaire française dont est symptomatique la fortune américaine de théoriciens tels que Foucault, Derrida ou Deleuze. Ce sont en effet ceux-là même qui ont le plus radicalement critiqué le monolithisme identitaire et la domination du sujet qui ont eu une reconnaissance transatlantique appuyée. Bien que l'auteur s'interroge sur le fracture hexagonale entre théorie et sphère politique, son argumentation ne va pas jusqu'à examiner la question complexe d'une identité française souvent réduite avec commodité à celle seule de la citoyenneté. Se dessine alors, sous-jacente à sa thèse d'une différance entre théories françaises et pratiques identitaires américaines, la nostalgie d'un logocentrisme et d'une lecture théorique légitime déclinée sur le double mode du « ce que certes nous ne faisons pas mais que les autres font bien mal »; une nostalgie dont était déjà empreint son précédent ouvrage, Queer Critics, la littérature française déshabillée par ses homos-lecteurs (PUF, 2002), consacré au cadre théorique queer anglo-saxon appliqué à la littérature française. Ce complexe de la lecture légitime est particulièrement perceptible dans l'analyse de l'utilisation « utilitariste » que les politiques identitaires américaines auraient faite de Derrida, un dévoiement que Christian Delacampagne qualifiait de « malentendu » dans un récent article publié à l'occasion de la mort du philosophe (« Histoire d'une success story », Le Monde, 11.10.04). Une perversion qui procèderait selon Cusset du hiatus entre l'enjeu de la déconstruction, comprise comme critique de la structure, de la connaissance et du rapport entre loi et écriture, et « la très vague définition littéraro-institutionnelle qui prévaut aux Etats-Unis : 'terme dénotant un style de lecture analytique qui tient pour suspect le contenu manifeste des textes' » (121). Plus loin, dans son chapitre consacré aux « Chantiers de la déconstruction », Cusset poursuit sa critique en soulignant que peu de réflexions politiques peuvent se réclamer de Derrida, tant sa pensée, déployée « en deçà du vrai et du faux » s'accommode mal de positionnements tranchés, de choix pratiques arrêtés ou d'engagements effectifs (136-137). Pourtant, ne peut-on pas se demander si les politiques identitaires à l'université n'ont pas constitué aux États-Unis, plutôt que le supposé dévoiement que Cusset stigmatise, le terreau favorable à l'épanouissement de la pensée de celui qui se décrivait comme « étant en synchronie avec la postcolonialité » (Arte, 13/10/04) et dont la critique de la métaphysique occidentale n'est pas sans lien avec sa propre histoire algérienne ? N'y a-t-il pas dans le développement des départements et programmes d'Etudes afro-américaines aux Etats-Unis une même remise en cause du logocentrisme, de la métaphysique occidentale, et de leur expression américaine à travers la question raciale ? Le hiatus ne semble pas si profond, si tant est que l'on comprenne l'étude des textes comme l'occasion de mettre au jour les liens entre philosophie, histoire et idéologie, une pratique dont la tradition afro-américaine fait tôt l'épreuve à travers la maîtrise de l'écriture par les esclaves. Par ailleurs, et pour ce qui est de l'inadéquation entre la philosophie dérridienne et le politique, l'argument est contredit par Derrida lui-même et notamment dans ses textes « Racism's Last Word » et « But, beyond…(Open Letter to Anne McClintock and Rob Nixon) » qui étudient les discours et l'idéologie du régime de l'apartheid (in Henry Louis Gates, Jr, «Race», Writing and Difference, 1986). Il est en outre surprenant de considérer que toute « structure d'opposition [étant] irréductible aux référents qu'elle affiche » empêche, si ce n'est de réduire à néant la dite structure, d'y infléchir les rapports d'inégalités. N'est-ce pas ce à quoi W. E. B. Du Bois et Frantz Fanon se sont attelés en rétablissant un sujet noir réaffirmé à la place de l'antithèse de la dialectique hégélienne du maître et de l'esclave, la négation de la négation ? C'est ainsi que French Theory présente également la faiblesse d'arrimer les penseurs des identités américaines et les critiques de la différence à une théorie française dont l'influence est postérieure à celle de larges mouvements sociaux de la dissidence et de la marginalité américains. Les Afro-Américains ont-ils attendu Derrida pour « déconstruire » la réalité matérielle et la métaphysique blanche américaine que la ségrégation leur renvoyait au visage ? « On Being Crazy » (1923) de Du Bois, qui s'attache à décrire le lien entre matérialité, langage et idéologie, est en cela un démenti frappant. En outre, lorsque Cusset fustige les départements de littérature américains pour avoir transformé la théorie française en un métadiscours subversif destiné à remettre les sciences en cause plutôt qu'à porter un regard sur le réel (chapitre « Littérature et théorie »), on touche à la limite du cadre interculturel. La distinction occidentale entre théorie / philosophie d'une part et littérature d'autre part est elle pertinente dans le cadre de la tradition afro-américaine pour laquelle la systématisation théorique, fût-elle littéraire, artistique, philosophique ou politique, s'ancre dans l'expérience, une subjectivité réflexive et non dans la connaissance objective du monde ? P. Guerlain: Le livre n'aborde pas suffisamment le paradoxe entre ce ferment politique de gauche sur les campus et la montée de la droite politique. Les catégories du multiculturalisme, qui découlent en partie de la French Theory, ont d'abord servi à rendre certains groupes et certaines méthodologies visibles et ont donc eu, dans les années 60 et 70, un effet positif indéniable mais elles favorisent aujourd'hui une réduction du politique aux catégories du marketing. Les « market niches » s'accommodent fort bien d'un découpage identitaire, en grande partie ethnique. Le multiculturalisme communautariste a été coopté par l'ultra-droite sans grande difficulté. L'hégémonie de l'ultra-droite américaine sur le champ politique s'accommode fort bien d'une politique de la différence qui ne va pas plus loin que la surface. Un Colin Powell ou une Condolezza Rice au gouvernement et la question du racisme est balayée. La politique de rélégation sociale dont sont victimes les pauvres, tous les pauvres mais les Noirs sont sur-représentés parmi les pauvres, disparaît de l'espace du débat politique derrière des querelles sémantiques, en partie inspirées par les débats universitaires liés aux nouvelles théories. (Lire Loïc Wacquant, Punir les Pauvres, sur ce point). Il ne s'agit pas tellement ici de parler de dépasser le marxisme ou non (il n'y a pas de théorie ou d'horizon indépassables) mais de ne pas rejeter la réflexion en termes de classes sociales et de fonctionnement socio-économique global au profit de logiques communautaires qui desservent toujours les communautés les plus marginalisées. L'université et la French theory ont participé à la déconstruction de tout universalisme, jugé abstrait, français et xénophobe, au profit d'un particularisme qui pourtant renouait avec des racines conservatrices et qui contribue à enfermer les groupes dans leurs appartenances communautaires et à gommer les liens qui peuvent exister entre groupes ethniques différents mais semblables sur le plan socio-économique.
Thierry Labica: Pouvait-on s'attendre à ce que les idées de Derrida soient politiques au sens traditionnel du terme ? Quant aux idées françaises, quel que soit le terreau d'accueil aux USA, elles bénéficiaient d'une écoute traditionnelle dans les milieux intellectuels américains, et ce depuis toujours. Le débat intellectuel français, sophistiqué et provocateur, fertilise les autres. En France, en revanche, les années 1980 et 1990 ont été celles du règlement de l'héritage intellectuel du PC, avec le rôle de Furet en particulier : les Français été occupés à autre chose. Cornelius Crowley: Quelle est la bonne définition du politique ? La décision ? L'acte d'opposition ? Qu'est-ce qu'une bonne position politique ? Agir ? Penser ? Tout ce travail hypertextualisé est éminemment politique. L'idée d'une autre politique à venir est bien chez Derrida. Il permet de dépasser les oppositions manichéennes, de voir le lien entre l'Amérique et le monde musulman. D'entrevoir un autre engagement. P. Guerlain : On ne peut nier une différence entre Derrida et des intellectuels comme Chomsky ou Saïd qui sont impliqués dans la politique du « réel ». André Kaenel : Le livre de FC est d'abord un bon livre d'histoire intellectuelle et culturelle comparée. C'est le genre de livre que la plupart de ceux qui, comme moi, enseignent les études américaines en France n'auront aucune peine à reconnaître comme le produit d'une véritable réflexion croisée sur les Etats-Unis. En même temps, comme toute réflexion croisée exercée à partir d'un point précis, en l'occurrence la France, le livre de F. Cusset propose également une réflexion sur nous-mêmes, intellectuels et chercheurs français ou européens, et sur nos pratiques. Le regard à la fois critique et admiratif que porte F. Cusset sur les appropriations et les détournements de la théorie française aux USA se double, dans son avant-dernier chapitre, d'une jérémiade, rhétorique politique bien américaine analysée par Sacvan Bercovitch, sur les résistances et l'hermétisme, de ce côté-ci de l'Atlantique, face au foisonnement théorique issu de ces appropriations et détournements. Le fait que French Theory ne soit cependant pas l'ouvrage d'un américaniste (sauf erreur) mais qu'il éclaire néanmoins les pratiques des enseignants-chercheurs travaillant sur les USA constitue un autre décalage à ajouter à ceux que le livre de F. Cusset éclaire si utilement. En effet, il nous explique qu'il n'y a pas eu de retour de théorie en France pour la French Theory pour des raisons qu'il énumère en fin de volume. Du moins n'y a-t-il pas eu de retour de l'ampleur du transfert vers les USA qui a eu lieu à partir du milieu des années 60. Toutefois, depuis quelques temps, un retour a lieu, modestement. Outre le livre de F. Cusset, cette journée d'étude en est un exemple. Ce retour s'opère, de façon significative, par le biais de la langue : sans la connaissance de l'anglais de son auteur, le livre de F. Cusset n'aurait pas vu le jour, du moins pas sous une forme aussi complète et réussie ; de même, la plupart de personnes qui interviennent lors de cette journée relèvent de la 11ème section du CNU (nos spécialités sont la littérature, la civilisation, l'histoire, l'anthropologie ou la sociolinguistique) et travaillent sur le domaine nord-américain. La langue anglaise, et les différentes spécialisations qui s'appuient sur elle, forment donc la passerelle première qui permet le retour de la French Theory, son appropriation et ses détournements par l'université française. On peut ici noter que c'était déjà la langue, mais le français cette fois, qui avait permis à l'origine le passage des idées de Derrida et Foucault aux USA, où elles avaient d'abord fait leur chemin dans des départements de français, avant de passer dans des départements d'anglais, puis de littérature comparée (Cusset, 89). Il en allait de même pour le volume Cultural Studies/Etudes culturelles publié aux PUN en début d'année, qui était l'œuvre d'anglicistes au sens large. J'ajoute que la communauté des anglicistes n'a pas le monopole des Cultural Studies, comme en témoignent les travaux effectués en France dans les domaines des études filmiques (cf. G. Sellier et N. Burch) ou dans celui de la sociologie des médias (cf. l'introduction aux CS de Mattelart et Neveu, publié en 2003 à La Découverte, chez le même éditeur que French Theory). Mais la connaissance de langue anglaise ne permet pas à elle seule d'expliquer les passages, transferts et appropriations de la théorie entre l'Europe et les USA — dans un sens comme dans l'autre. Le livre de François Cusset nous rappelle l'importance capitale des personnes et des institutions dans la transmission des savoirs et des idées. Plutôt que de parler au nom des autres collègues, je mentionnerai ici, au travers de quelques jalons de ma propre histoire intellectuelle, les circonstances dans lesquelles je me suis trouvé à trafiquer avec la théorie dans le cadre de mes recherches sur la littérature et la culture américaines. Il m'est difficile de traiter séparément les relais institutionnels et personnels. C'est à l'Université de Genève, dans le département d'anglais, vers le milieu des années 1980, que le vent de la French Theory a commencé à souffler sur mes travaux en littérature américaine. Une thèse de doctorat sur la figure de l'auteur dans l'œuvre de Melville m'avait amené a m'intéresser à la manière dont l'espace public américain au milieu du XIXè siècle concevait la figure de l'auteur, comment un discours public (et politique) sur l'auteur se faisait jour dans un contexte de nationalisme culturel exacerbé. Les enseignants du département d'anglais, professeurs ou assistants, comme moi, étaient alors majoritairement anglophones, issus des meilleures universités britanniques et américaines. Les débats sur le canon littéraire qui avaient commencé à agiter Cambridge et Yale trouvaient naturellement un écho dans leurs pratiques pédagogiques, fortement marquées par l'influence de la déconstruction et par l'impact des Cultural Studies en Grande-Bretagne (son impact américain devait se faire sentir quelques années plus tard). C'est un plaisir pour moi que de rendre hommage, pour la première fois publiquement, à ces collègues et passeurs d'exception, parmi lesquels John Higgins, Pete de Bolla, Tom Ferraro, Bill Readings (l'auteur de The University in Ruins, mort dans un accident d'avion il y a tout juste 10 ans). A la faveur de cours parfois assurés en commun, de discussions informelles, de séminaires de type work in progress, et encouragé par la liberté que nous laissait l'institution d'offrir les enseignements de notre choix, mes cours et ma recherche se sont ouverts à certaines des idées alors en vogue aux USA et en Grande-Bretagne. C'est dans ce milieu intellectuel, extrêmement fertile sur les plans personnel et académique, que je me suis tourné vers les travaux de Michel Foucault et de Pierre Bourdieu pour comprendre l'enchevêtrement, dans le champ littéraire américain au XIXè siècle, des discours (juridiques, moraux ou politiques) et des institutions (la question du droit d'auteur, par exemple). Et pour comprendre comment, à l'intérieur de ce champ en mutation, et souvent contre ses règles, Melville construisit sa trajectoire d'écrivain. La théorie française, qui ne s'appelait pas encore ainsi, opérait là, pour moi, un retour dans une contexte cosmopolite francophone, mais non français, après un détour par Cambridge, Oxford, Duke ou Yale. Yale, justement, où je devais passer une année en tant que chercheur invité en 1988-1989, pour poursuivre mes recherches sur Melville, était alors secouée par l'affaire Paul de Man, à laquelle FC consacre plusieurs pages. Je rappelle ici ces révélations, faites en 1986, selon lesquelles le critique d'origine belge, professeur à Yale jusqu'à sa mort en 1983, avait signé des articles à teneur antisémite dans un journal bruxellois durant la Seconde Guerre mondiale. Il y eut à l'époque un colloque tendu consacré à l'héritage de de Man en présence de ses anciens collègues et amis : nombreux étaient les enseignants et les collègues à voir alors dans l'affaire de Man le début de la fin de la « déconstruction ». Autre souvenir de cette année : le nom « Derrida » écrit en grand à la mousse à raser sur un sentier du campus et dont il ne restait déjà plus qu'une trace à peine lisible. En quittant il y a une dizaine d'années l'Université de Genève pour l'Education nationale, la Suisse pour l'Europe, c'est un autre déplacement que j'ai opéré, d'une réflexion centrée sur la littérature américaine à une autre sur un objet que je découvrais alors, la « civilisation ». Ce champ non disciplinaire qu'on disait transdisciplinaire, reposait (repose ?) sur des fondements positivistes étroits et envisageait l'étude de la civilisation britannique ou américaine dans une optique principalement entomologique (il s'agissait d'épingler le système politique, les institutions, la population, l'immigration, etc.) — d'où la réflexion sur le champ lui-même était absente. Ceci alors que les Etudes américaines aux USA étaient en train de prendre un tournant théorique sous les coups de butoir des « Nouveaux américanistes » (New Americanists). Autour de la figure de Donald Pease, ces nouveaux américanistes insufflaient à un champ jusqu'alors hostile à la théorie et historiquement centré sur la nation américaine, un parfum continental, dont le canal privilégié était Althusser et la critique idéologique. Certains de leurs textes, d'un abord souvent difficile, ont nourri ma réflexion sur l'exportation culturelle américaine à l'époque de la Guerre froide, dont participaient d'ailleurs l'encouragement en Europe des American Studies dès la fin des années quarante. D'autres projets de recherche, en cours ou en veilleuse, sur le cinéma américain se sont nourris de travaux dans la mouvance des Cultural Studies américains sur l'identité nationale et post-nationale dans un contexte de mondialisation, ou sur la réception des produits culturels (e.g. sur l'apocalypse nucléaire dans le cinéma de la Guerre froide, sur l'image du pouvoir et de la Présidence américaine, ou sur le « siècle américain au cinéma entre Pearl Harbor et le 11 septembre »). A chacune de ces étapes du parcours (Melville, l'exportation des études américaines ou le cinéma) la théorie, qu'elle soit française ou non, a fait partie de ma boîte à outil. Si je n'étais pas si maladroit avec le marteau ou l'équerre, je revendiquerais volontiers la définition que donnait Laurence Grossberg des Cultural Studies comme « bricolage ». En tous les cas, ma démarche intellectuelle doit beaucoup aux déplacements, aux décrochages et aux décalages qu'analyse si bien F. Cusset dans son livre. Les CS, en particulier, me paraissent fournir un ensemble de textes, de protocoles intellectuels, de démarches, et de concepts fertiles pour penser une pratique d'enseignant et de chercheur en « civilisation » américaine dans le contexte institutionnel précis de l'Université française. Ce qui ne revient pas à dire que tout est bon à prendre dans les CS (cerner ce « tout » me paraît d'ailleurs difficile). Les dérives textualistes relevées par F. Cusset sont réelles (ce que Mattelart et Neveu appellent dans l'un des sous-titres de leur livre le « théoricisme chic et choc comme ersatz d'engagement »). En même temps, la vitalité du champ des CS, son bouillonnement et les possibilités de croisements qu'il ouvre en font un outil utile pour fendiller la gangue positiviste des études de « civilisation »). Guillaume Marche : Il s'agit d'un livre très érudit, qui situe de manière utile la genèse en France et le devenir aux Etats-Unis de la « French Theory ». L'auteur fait une sociologie des savoirs — notamment philosophiques — et de la vie universitaire américaine très convaincante. Mais son traitement des références sociologiques l'est moins : il va trop vite en besogne pour réduire « la » sociologie américaine à un « héritage positiviste » (106). Le chapitre 13 et la conclusion donnent néanmoins à réfléchir sur la dichotomie texte/société, dont certains usages de la « French Theory » cherchent à dépasser le caractère bloquant. Dans les pages 343 et suivantes, Cusset formule même les termes d'un dépassement indispensable de la dichotomie universalisme/différentialisme, qui tend à assimiler — à tort — différentialisme, essentialisme et séparatisme. Se pose in fine la question de l'usage de la théorie : c'est surtout selon qu'elle est descriptive ou prescriptive qu'elle s'avère en phase ou en décalage avec le terrain et l'expérience des acteurs : là se situe, par exemple, l'un des écueils de la théorie queer, qui a tendance à traiter les mobilisations sur le terrain comme si elles étaient, pour ainsi dire, en retard sur la théorie (164-167). D'autres auteurs se proposent plutôt de rendre compte des mobilisations fondées sur l'expérience afin d'en explorer le sens tout en les accompagnant (cf. Kath Weston. Long Slow Burn : Sexuality and Social Science. Routledge 1998). Marc Deneire : Avoir vécu sur différents campus américains de 1986 à 1998, c'est avoir participé à une immense conversation, un aller-retour entre les contacts personnels et les textes. D'une université à l'autre, d'un département à l'autre, des références communes (comme Michel de Certeau), qui n'étaient d'ailleurs pas seulement françaises (Habermas en faisait partie). A la fin des années 1980, c'était la fin du New Criticism et la découverte de Derrida a permis un renouvellement autour de la déconstruction. La théorie a permis de se positionner dans le cadre d'une pratique discursive, et également de « s'éclater », se faire plaisir et éclater les points de vue, les identités. Pour ceux qui ont eu cette expérience américaine, tout retour en France est difficile : l'anti-multiculturalisme est dominant. Autre différence : si les universitaires et intellectuels américains sont séparés de leur base, ils sont au moins unis dans leur communauté par cette conversation. Cornelius Crowley : Les années 1980 ont vu en France la non-rencontre de cette théorie française, de la réflexion politique telle que Derrida et Foucault avaient pu l'imaginer, et de la gauche enfin au pouvoir. P-Guerlain et T. Labica s'interrogent pour finir sur ce paysage intellectuel et universitaire français depuis les années 1980, champ occupé également par Lacan en matière de mode intellectuelle dans les années 70 ou Bourdieu (dont Cusset parle peu). La mode ne laisse pas forcément toujours de la place à tous les penseurs importants et parfois met en lumière des penseurs plus médiatiques ou flamboyants que profonds. Bourdieu est finalement peut-être plus important sur le plan scientifiques que d'autres qui ont eu plus de succès à un moment donné sur les campus américains. Indications bibliographiques: CHAMOISEAU, Patrick. Ecrire en pays dominé. Paris : Gallimard, 1997. |
||